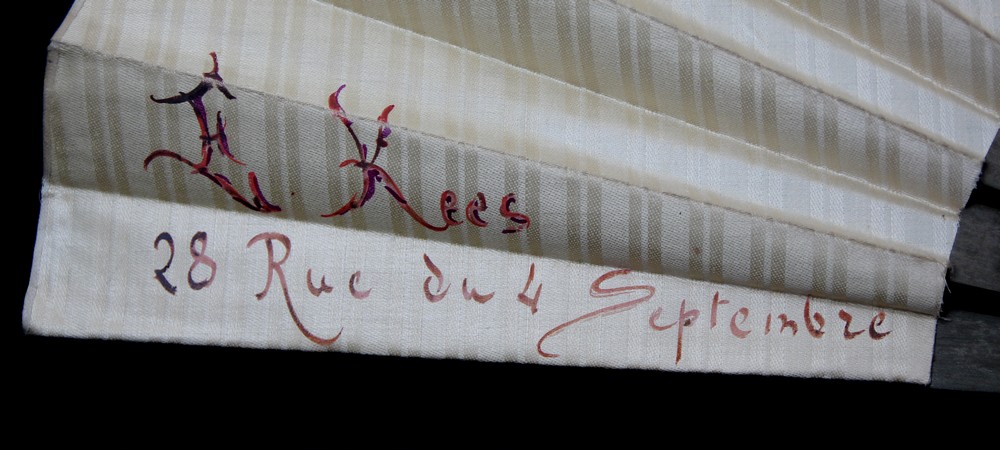Le Dix-Neuvième siècle français, et le
début du XXème, avaient moins peur de la caricature que notre début du
XXIe siècle, et bien des polémistes ou dessinateurs de l'époque
auraient en 2016 été mis à l'amende, voire en prison, pour les textes
ou les dessins irrévérencieux qu'ils produisaient alors. Et fort
heureusement, personne ne pensait alors à les
occire. L'anticléricalisme en particulier prenait alors une ampleur que
les
régimes précédents n'avaient pas toléré. Il en reste des traces dans
l'une des conceptions françaises de la laïcité, qui se voit toujours
non comme respect des religions et des consciences mais comme combat
contre une Église Catholique triomphante qui appartient pourtant au
passé.
Est-ce dans cette veine que se trouvent les éventails que nous présentons
ci-dessous ? Nous ne le savons pas, et c'est pourquoi nous interrogeons
nos lecteurs.
Le Capucin diabolique ?
Cet éventail "plein vol" dispose d'une monture en bois (fruitier ?)
teinté en vert bronze, brins repercés de motifs foliacés, panaches
sculptés de même en ronde bosse. La rivure est en métal avec bélière
laiton.. La feuille double est en tissu (satin ?) La face est gouachée,
le dos tissé en rayures ton sur ton.
La face est particulièrement originale. A côté d'un élément
d'architecture sur lequel est écrit : "Couvent des Capucins - Salle
Pérot, 27 avril 1881", un moine capucin, chapelet au cou, tête enfoncée
sous son capuchon, tient de la main droite un crucifix et de la gauche
fait un geste qui semble destiné à repousser (plus qu'à bénir) un
essaim de dix créatures fantastiques qui apparaissent dans un nuage
lumineux. A gauche, la plus proche du moine est quadrupède, dotée d'un
long cou et, semble-t-il, de deux seins oblongs pointés vers le ciel.
Au centre une autre, sombre, ressemble à une araignée à quatre pattes.
A droite figure un autre monstre bipède, à long bec et large œil avec
queue et crête mais sans ailes visibles. Au dessus se pressent sept
créatures volantes dont deux ou trois ressemblent vaguement à des
oiseaux, les autres étant parfaitement fantastiques.

Nous n'avions jamais vu un tel éventail... jusqu'à ce qu'en 2023, nous
en trouvions un second (ou un deuxième ? -subtilité réservée à la
version française de cette page !-). Le voici :

Kathy Maxwell, collectionneuse et chercheuse australienne, nous a
rappelé un
éventail de la maison Alexandre, par Clairin, montré par la Vie
Parisienne en 1883, et a peut être été inspiré par le premeier objet que nous
montrons. Cet éventail (ou un similaire, car les dessins ne sont pas
identiques) appartient au Fan Museum de Londres, et peut être vu ici.
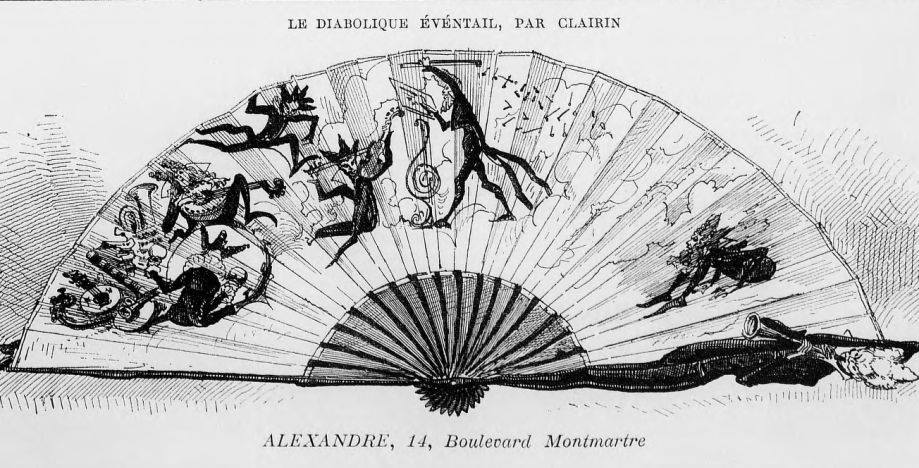
(photo B.n.F. www.gallica.fr)
Quant aux éventails que nous étudions, le premier fut d'abord présenté en vente sans attirer les
enchérisseurs, peut-être en raison de son caractère étrange, et d'une
description qui, véridique peut-être, n'en était que plus inquiétante.
Mme Lucie Saboudjian, expert, dont (certainement ès-éventails, et
peut-être en matière de capucins et de succubes ?) l'expérience
est longue et la compétence reconnue, avait en effet titré ce lot "le
Capucin diabolique", et y voyait "un capucin invoquant les succubes".
Voilà, à notre avis, de quoi faire reculer les habituelles acheteuses
d'éventails ! Bien sûr, il s'agissait là d'une notation humoristique
destinée à détendre la salle de ventes.
Que
sont en effet les succubes ? On n'en rencontrait semble-t-il pas en
2016 quand nous avons publié cette page, et pas plus depuis, malgré les guerres, les épidémies ou les
manifestations diverses qui ont agité le monde et en particulier
la France. Du moins ne les reconnait-on pas ! L'étymologie est à la
portée du latiniste débutant puisque le mot est formé de sub (sous) et
de cubare (coucher). Le dictionnaire Littré en donne la définition
suivante : "Démon qui, suivant l'opinion
populaire, prend la forme d'une femme pour avoir commerce avec un
homme". L'Académie
Française, dans la 8ème édition de son dictionnaire, dit la même chose,
et n'a guère varié au fil du temps puisqu'en 1718 elle écrivait :
"Succube, sustan. masc. On
appelle ainsi le démon, lorsque, suivant
l'opinion de certaines gens, il prend la forme d'une femme pour avoir
la compagnie charnelle d'un homme." L'Académie reliait le mot à son antonyme : "Incube", dont la définition était :
"Sorte de démon qui, suivant une erreur populaire, abuse des femmes". Nous laisserons nos lecteurs adeptes des
études de genre réfléchir aux différences entre ces deux définitions.
En tout cas, nous ne voyons pas ici, hélas, de charmantes
jeunes femmes mais sans doute les démons avant qu'ils n'en prennent
l'apparence. Mais peut-on confirmer cette présentation ? Il est
incontestable que le moine représenté porte un vêtement qui est celui
des moines de la famille franciscaine (créée par Saint François
d'Assise, cher au Pape qui lui a emprunté son prénom). Les capucins se
caractérisent par l'usage du capuchon qui, par sa couleur et le fait
que leur bure comporte parfois une partie blanche a donné son nom au
célèbre cappuccino. A n'en pas douter, comme en témoigne ci-dessous un
tableau de Zurbaran montrant le saint, le moine ici
représenté est bien un capucin. On voit d'ailleurs flotter sa
cordelière, dont les nœuds rappellent les vœux de pauvreté, chasteté
et obéissance. Le deuxième serait fortement compromis par l'action des
succubes...
 
Museu Nacional d'Art de
Catalunya
Inventory number: 011528-000
Le capucin de l'éventail invoque-t-il les succubes ? (Si ce sont des
succubes : rappelons que pour tromper les hommes ils prennent des
formes plus attirantes !!!). Nous penserions plutôt qu'il les repousse,
avant d'avoir succombé aux charmes de leurs avatars... ou après. Ce
serait ce "Vade retro, Satanas" accompagné du geste de la main et de la
présentation du crucifix qui amènerait la matérialisation des démons
sous leur forme réelle, de nature, il faut bien le dire, à dissuader du
péché de la chair.

Que voyons nous sur le second (et peut-être deuxième ?) éventail ? Le
moine est turné dans l'utre sens, il tient toujours un chapeler à la
main mais plus de croix et sous sa capuche un croit deviner un visage
barbu affublé d'un nez plus bulbeux que crochu ! Les succubes ont
disparu, mais le mystérieux capucin est désormais accompagné d'un
cochon jouant d'un instrument à cordes (peut-être un luth ?). On
trouve assez facilement sur l'internet des dessins de cochons jouant de
la guitare (et même un vrai cochon !!!) mais nous n'en avons pas vu
datant d'avant 1881, ce qui fait peut-être de cet éventail un objet
précurseur.
Pourquoi cette scène sur un éventail ?
Mais quelle que soit l'interprétation donnée à ces scènes, comment
diable (oserons-nous dire) se trouve-t-elle sur un éventail, objet
féminin davantage peuplé d'amours, de divinités antiques ou de scènes
bibliques que de démons, de franciscains et de cochons ? (encore que nous montrons sur ce site un autre éventail "cochon"...)
Il faut, bien sûr, se placer à la date de l'éventail : 1881. En cette
fin de siècle, la Science se pense sur le point de vaincre toutes les
superstitions, mais en demeure parfois proche. Jean-Baptiste Charcot
(1822-1893) atteint cette année là la consécration. En étudiant
l'hystérie, il ouvre la voie à Freud, mais s'attire aussi des
critiques. Dans Magnétismes,
en 1882, G de Maupassant l'appellera un : " éleveur d'hystériques en chambre (…) auxquelles il
inocule la folie et dont il fait, en peu de temps, des
démoniaques". Se développe aussi
alors en Europe, en
parallèle du spiritisme (des gens sérieux font tourner les tables,
invoquent les esprits et font parler les morts), un courant sataniste.
Pour nous en tenir à la France, on peut évoquer Les Diaboliques de
Barbey d'Aurévilly, livre paru en 1874 mais saisi, et republié en 1882.
Il faut surtout citer J.-K. Huysmans qui fera la part belle au
satanisme dans son roman Là-Bas,
(1891). Le cas historique de Gilles de Rais permet au romancier
d'aborder les
manifestations contemporaines (messes noires, ésotérisme, kabbale,
occultisme). Notons ici que c'est dans ce noir tableau qu'Huysmans
commencera la réflexion qui l'amènera à la foi catholique, où le
suivront nombre d'intellectuels de l'époque. Sur l'éventail
aussi, le capucin réussit peut-être à chasser les démons ?
Concernant l'autre éventail, il est difficile a priori de connaître la
signification de la présence du cochon. Cet animal fait certes l'objet
depuis des siècles de caricatures. Il est souvent associé à la luxure,
mais aussi à la saleté, voire dans des caricatures antisémites (la
religion juive prohibant la consommation de porcs...)? Un seul exemple
contemporait de l'éventail sera montré avec des caricatures
s'attaquant Emile Zola, présenté comme trop "matérialiste" et
porpnographe. Ces caricatures sont empruntées à John Grand-Carteret, Zola en Images, Paris, Félix Juven, s.d. [1907]
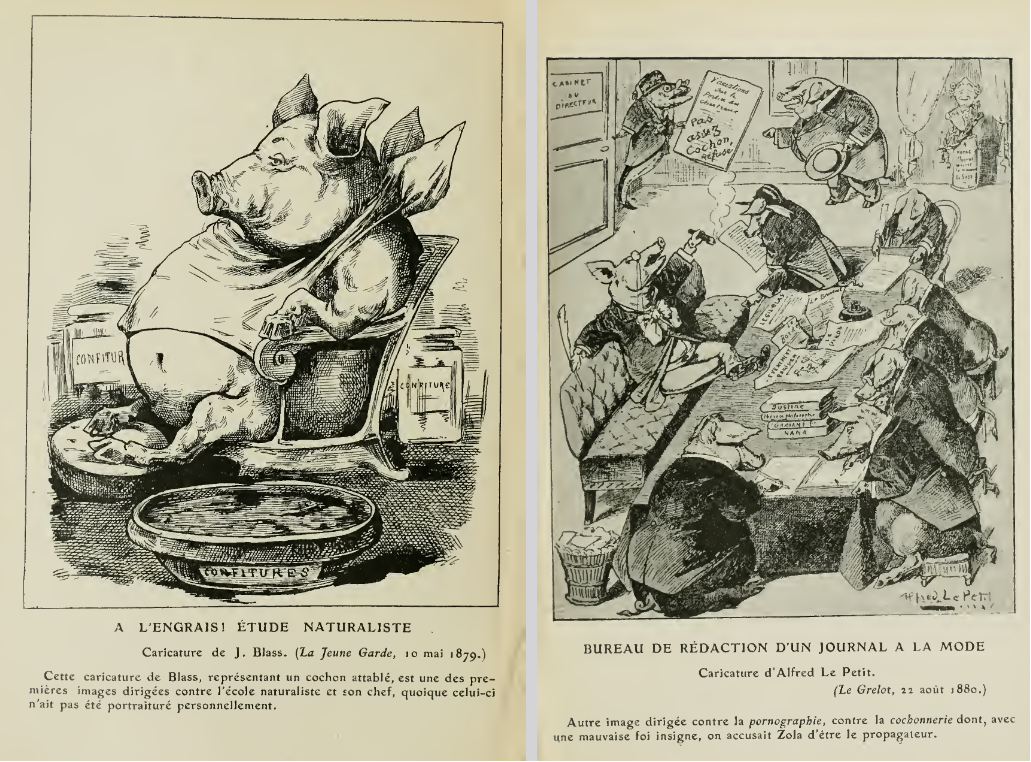
Mais il nous est difficile d'imaginer que notre éventail soit en relation avec ce type de caricatures politiques. Pour
approcher davantage de la signification de cet éventail, il nous faut
nous intéresser à l'inscription : "Couvent des Capucins - Salle Pérot",
27 avril 1881.
Cette salle Pérot est
difficile à
localiser précisément, car elle a certainement disparu, et que nous lui
trouvons diverses adresses : 18 ou 20, rue Ordener, 5, bd de la
Chapelle,
29, rue Riquet : toutes rues qui se trouvent au nord du quartier
populaire
de la Goutte d'Or, près des voies de chemin de fer, avec des
numérotations qui ont évolué et un bâti qui n'a cessé de se modifier,
malgré des éléments constants, depuis 1881.
La Salle Pérot est
connue comme lieu d'activités politiques et syndicales. On sait qu'un
club blanquiste y existait en 1870, animé par le révolutionnaire,
libre-penseur et franc-maçon Théophile Ferré (fusillé en 1871). Dans
son journal, en évoquant son action pendant la Commune de Paris, la
célèbre Louise Michel écrit ainsi, à propos des "comités de vigilance"
révolutionnaires de Montmartre : "Le soir, je trouvais moyen
d’être aux deux clubs, puisque celui des femmes, rue de la Chapelle, à
la justice de paix, s’ouvrait le premier. Nous pouvions ainsi assister
après à la moitié de la séance du club de la salle Pérot, quelquefois à
la séance entière ; tous deux portaient le nom de club de la
Révolution distinct des Grands-Carrières".
Lors de grèves des cheminots
en 1910, cette salle jouait aussi son rôle, puisque, selon le Petit Parisien du lundi 10 octobre
1910,
"Les grévistes des dépôts qui n’ont tenu, hier, aucune réunion sont
convoqués pour ce matin six heures, à la salle Pérot 20, rue Ordener". A la même époque, comme le montre l'affiche
ci-dessous, le Parti
Socialiste y organisait une réunion pronant la régulation des
naissances, le "Libre Amour" et la "Libre Maternité".
La Salle Pérot semble avoir un
lien avec la salle Garrigues, où " les citoyens de Clichy,
réunis le 17
mai 1903, grande salle Garrigues, au nombre de 600, sous la présidence
de M. Mascuraud, déclarent ne plus vouloir payer les prêtres et
réclament la séparation des Églises et de l'État, la laïcisation
complète de la République " et
qui sera peu après le siège du journal L'Anarchie, qui abritera un
temps le belgo-russe Victor Serge, révolutionnaire et écrivain
francophone.
En bref, cette Salle Pérot n'a bien sûr jamais abrité de Couvent des
Capucins, mais sans aucun doute accueilli nombre de militants et de
syndicalistes révolutionnaires, socialistes, libre-penseurs,
anarchistes.
Mais qu'y faisait-on le
27 avril 1881 ?
Quelques mots
sur l'éventailliste Kees
Nous n'allons pas ici faire l'histoire de Kees, qui a fait l'objet il y
a quelques années d'une exposition au regretté Musée de l'Eventail de
Paris, avec livret de Georgina Letourmy. Mais puisque cet éventail
porte au dos la signature d'Ernest Kees, nous saisissons cette occasion
pour en dire quelques mots.
Tout d'abord, comment doit-on prononcer ce nom ? Il est courant, sous
l'influence de la domination de la langue anglo-américaine, de
l'entendre prononcer "Kiss" (surtout par des Français, les anglo-saxons
allongeant la syllabe pour tenir compte des deux "e"). L'éventailliste
Sylvain Le Guen, pas encore "maître d'art" et à la tête d'une "Maison"
parisienne, mais déjà talentueux, joua avec cette prononciation pour
réaliser l'amusant éventail que nous montrons ci-dessous.
Toutefois, la prononciation ne pouvait en réalité être que "Kess" en
raison de l'origine germanique de la famille (que nous avons indiquée
dans l'article de Wikipédia ©
qui lui est consacré)... Nous n'en donnerons pour preuve que la
"publicité rédactionnelle" reproduite ci-dessus. Elle fut publiée dans Le Livre d'Or des Fiançailles & du
Mariage,
alors qu'Ernest Kees avait cédé son affaire à Alfred Marie, installé en
1890 au 9 boulevard des Capucines. Et comme on le voit, l'orthographe
même de Kees est transformée en Kess... ce qui aurait été aberrant si
la prononciation avait été "Kiss" !
Mais, pour en revenir à nos "éventails au Capucin diabolique", nous
nous contenterons de regarder les belles signatures qui en ornent le revers.
Comme il se doit, puisque les éventails sont réalisés en 1881, l'adresse
d'Ernest Kees est toujours le 28, rue du Quatre-Septembre.
L'alliance des Capucines et de ce capucin eût été plaisante !
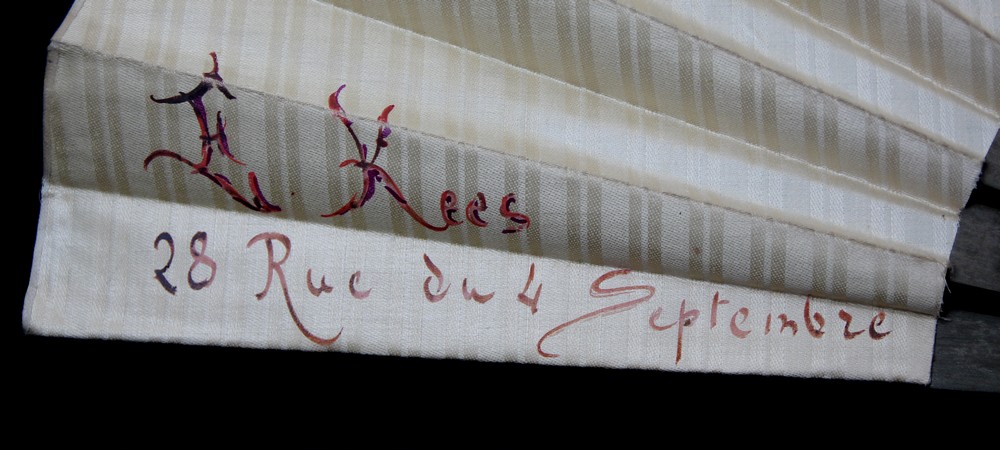 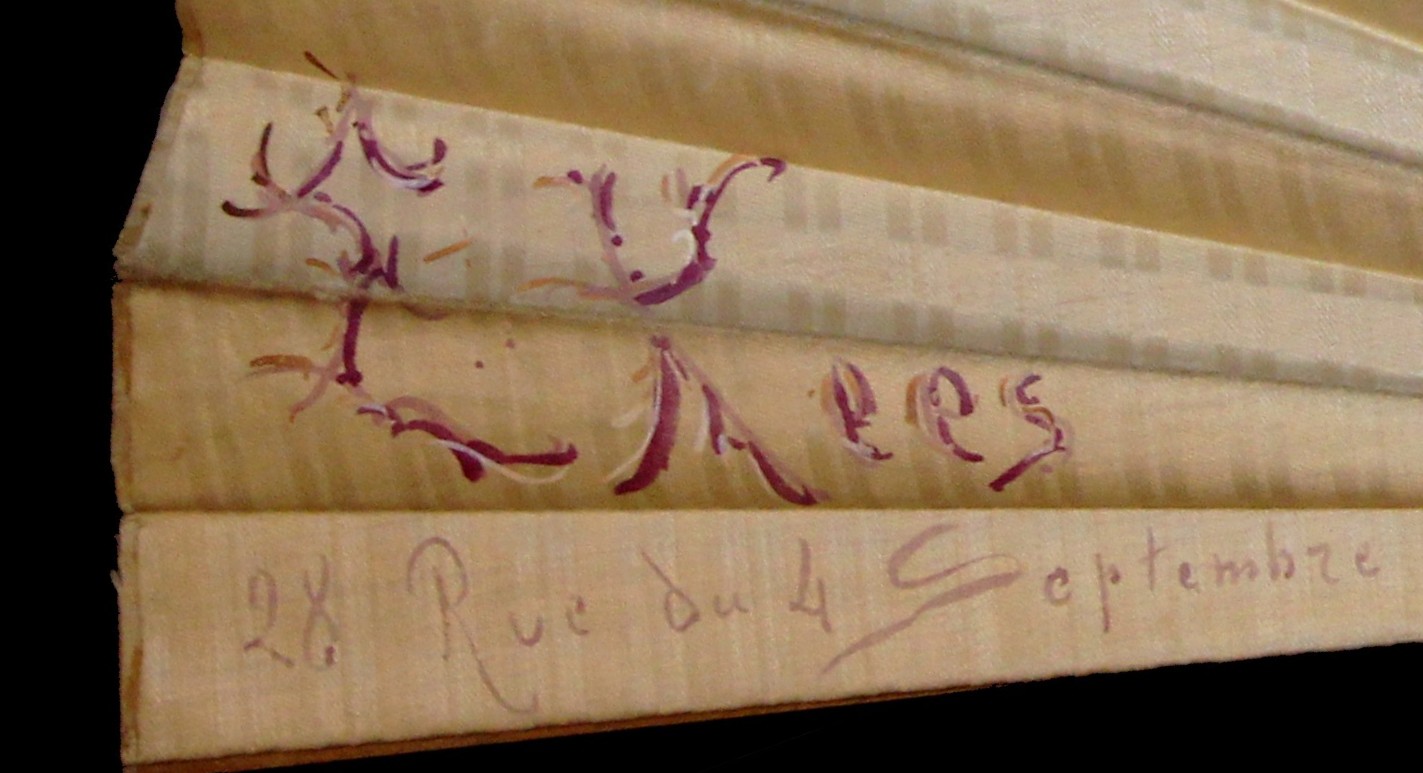
Questions à nos aimables visiteurs
Nous conservons hélas les questions posées en 2016. Ce sont de vraies questions, auxquelles nous ne pouvons malgré
nos recherches apporter de réponse.
1) Que s'est-il passé le
27 avril 1881 Salle Pérot ?
2)
La signature
manuscrite d'Ernest Kees (peintre assez doué, on le sait) au dos des
éventails, plus élaborée que souvent, peut-elle être signe qu'il
serait l'auteur des peintures qui ornent la face de ces éventails ?
3) Avez vous déjà vu (et
où ?) les surréalistes créatures ou le guitariste cochon qui ornent cet objet ?
Ayez l'amabilité de nous
répondre (ou de nous faire part de tout avis ou remarque) par le lien
figurant en page d'accueil du
site. Nous ne manquerons pas de vous remercier, et de partager vos
trouvailles, dès lors qu'elles nous feront avancer vers la vérité.
Premières réponses
Lors de la publication de cette page, bon nombre de personnes nous
firent part de leurs opinions, par courriel, via Facebook (page de
votre serviteur (https://www.facebook.com/pierrehenri.biger),
celle du Fan Circle International (https://www.facebook.com/fan.circle?fref=ts),
ou celle des Collecionisti de Ventagli (https://www.facebook.com/groups/104785799621603/?fref=ts)
et nous les en remercions
1) vous êtiez nombreux à
voir un bec sous le capuchon du capucin, et plusieurs notaient aussi que
les mains et un pied, sous la bure, semblaient munis de serres. Ceci
ferait du Capucin lui-même une créature diabolique. Pour tout vous
dire, nous avions nous-même eu ce sentiment, mais pour ne pas
influencer nos visiteurs, avions préféré n'en rien dire ;
2) Aldo Dente, spécialiste
italien des éventails reconnu, a remarqué que le crucifix parait tenu à
l'envers, ce qui renforce l'idée d'un rituel satanique ;
3) Feu notre ami Gérald Gould,
époux de Sylvie (émérite collectionneuse) pensait à l'usage de substances
hallucinogènes, et plusieurs correspondants mentionnaient une parenté
avec Jérôme Bosch. Une
correspondante trouve que la
créature-araignée noire en premier plan ne semble pas de la même main
que le reste ; mais, regardant l'éventail en mains, nous pensons que
cette impression vient du fait que cette créature se trouve vue à
contrejour du nuage lumineux.
4) sans que l'on puisse
hélas trouver là un lien direct, le Dr Alice Labourg (université Rennes
2), dont la thèse portait sur L'imaginaire pictural
dans les romans gothiques d'Ann Radcliffe, faisait un rapprochement judicieux avec les
œuvres de ce genre, et en particulier avec The Monk de G. W. Lewis.
|
L'hypothèse "diabolique" se précisant,
fût-ce de manière parodique ou caricaturale, mais sans aucun doute
anticléricale, nous ajouterons que le sujet était à la mode depuis la
publication en 1875 par Isidore Liseux (lui-même défroqué, latiniste,
éditeur et connu pour son athéisme militant) d'un manuscrit du R.P. Ludovico Maria Sinistrari (1632-1701), De
la Démonialité et des animaux incubes et succubes, où l'on prouve qu'il
existe sur terre des créatures raisonnables autres que l'homme ayant
comme lui un corps et une âme, naissant et mourant comme lui, rachetées
par N.S. Jésus-Christ et capables de salut ou de damnation. Cet
ouvrage, semble-t-il authentique, parle notamment de la réalité et
de
la nature des succubes et incubes (qui ne seraient pas des démons...).
Ajoutons que par nous
mêmes, nous
avons trouvé mention, dans diverses histoires des rues de Paris ou de
Montmartre, d'un "Bal Pérot" situé rue de La Chapelle qui selon
toute
vraisemblance a fait place à la "Salle" du même nom. Cela se serait
fait d'autant plus facilement que, si l'on en croit le journal L'Union Monarchique du
Finistère
du samedi 22 mars 1884, les réunions politiques se terminaient parfois
en bal (cf. ci-contre) . Notre
éventail appartenait peut-être à cette
catégorie mixte.
Ce "couvent des
Capucins" serait alors un précurseur du café-cabaret de l'Enfer, 53
Boulevard de Clichy à Paris. Celui-ci (voir photo à gauche)
fut probablement le
pionnier des cafés et restaurants abordant ce thème. Il fut crée fin
19ème et subsista jusqu'au milieu du 20ème. Selon un témoignage datant
de 1899, les convives de Satan étaient accueillis par ces mots :
"Entrez et soyez damné !".
Les serveurs du café de l’enfer étaient tous vêtus en démon. Un autre
témoignagne nous explique qu’une commande de trois cafés noirs enrichis
de cognac se transformaient en : "Trois chocs bouillonnants de
péchés en fusion, avec une pincée de soufre intensificateur".
Juste à côté du café de l’Enfer, on pouvait trouver le café « Le Ciel ».
(cf.http://www.paperblog.fr/6103382/le-cafe-de-l-enfer/)
|
Nous
ajoutons ci-dessous, à propos du "café de l'Enfer", et pour ceux qui
voudraient s'aventurer dans des études plus sérieuses du sujet, ce
qu'écrit Julie Gonzalez en introduction d'une savante thèse d'Histoire
de l'Art (Etude iconographique de la
gueule d'enfer au Moyen Age. Origines et symboliques : iconographie et
sources textuelles), soutenue à Pau en 2015 et disponible en
ligne. Notre Capucin de l'éventail est certainement dans la même
lignée.
Gueule%20de%20l'enfer.pdf
Terminons
en signalant une parenté évidente : celle des "fantasmagories" de
Robertson, dont les projections de lanterne magique avec spectres,
fantômes et créatures mystérieuses avaient lieu en 1799 dans l'ancien
couvent des Capucins de la rue Saint Honoré, faisant écrire à
Chateaubriand : "La communauté des Capucins est saccagée. La clôture
intérieure sert de retraite à la fantasmagorie de Robertson". Mais
c'est là un sujet sur lequel nous reviendrons sans doute un jour, à
propos d'un autre éventail.
Merci pour vos réponses (voir adresse en page d'accueil)
et ne pas oublier
d'aller voir nos autres
questions !
|